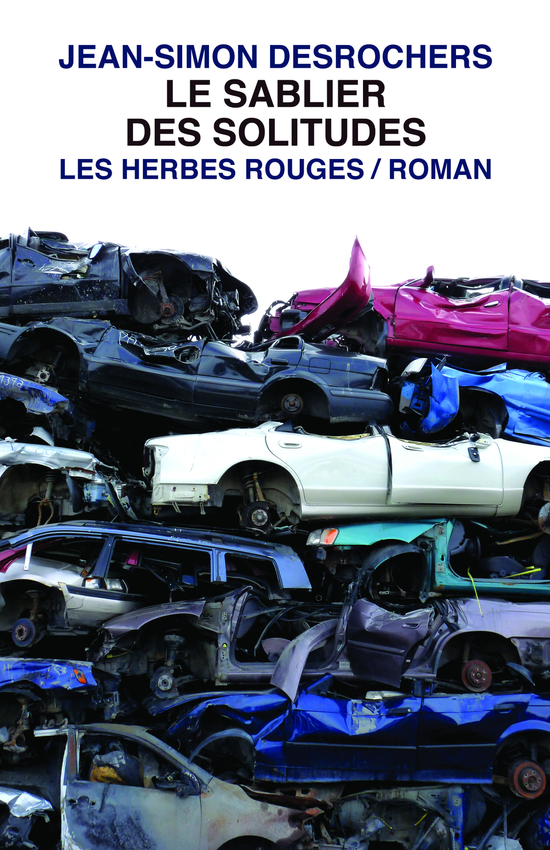"J’aimerais résilier mon abonnement. Puis-je m’y prendre ainsi? Cordialement,
E. Rothner."
Lorsqu’on lit les premières lignes de Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glattauer, on ne se doute aucunement dans quoi on s’embarquera, tout comme les deux protagonistes. Par ce simple et anodin courriel, Emma Rothner fera débouler quelques choses de plus grandes qu’elles, une rencontre qu’elle n’attendait pas, une expérience qu’on n’espérait plus.
Lorsque Leo Leike recevra cette demande de résiliation dans sa boite courriel, lui aussi ne se doute pas de ce qu’il attend. De ce quiproquo banal naitra une relation épistolaire grandiose, remplie de curiosité, d’intrigue, d’intérêt et d’abus. Car rapidement cette relation deviendra tout sauf saine, rapidement nos deux comparses seront dépendant aux lignes de l’autre, ils vivront que pour ces instants de fin de soirée, assis pathétiquement devant leur écran d’ordinateur, dans l’attente interminable d’un nouveau courriel, d’une nouvelle ligne, d’un seul mot.
Glattauer trace ici un portrait simple, mais tremblant de vérité de l’amour en 2011. Bien plus qu’une simple histoire d’amour, Quand souffle le vent du Nord relate l’impact inhérent des nouvelles technologies de l’information dans nos relations interpersonnelles, dans nos espaces sociaux. Quand est-il des rendez-vous galants, des soirées à la recherche de l’amour avec un grand A, des papillons de la première fois, des rouages du charme et des fameuses premières impressions à l’ère de l’amour 2.0?
Ce bouquin porte une prémisse sympathique qui deviendra de plus en plus intense alors que leur relation viendra bousculer leur réalité, leur petit monde. Ce qui était au départ qu’une simple distraction deviendra rapidement un jeu dangereux, et même s’il s’en rendre compte, il leur semble impossible de s’en arrêter. La dernière ligne de Quand souffle le vent du Nord ne laissera personne indemne, pas même le lecteur. Et bien que certains seront satisfaits, plusieurs resteront sur leur faim, et c’est pourquoi Glattauer à écrit La septième vague, le roman que vient clore le diptyque de Leo et Emmi. Bien que parfois redondant, on est plus qu’heureux de retrouver ces courriels. Pour certains ce sera une vraie fin, alors que pour moi, ce n’était qu’un long épilogue. La septième vague est un bon bouquin, sans être nécessaire, le charme opère, mais n’innove pas.
Le lecteur ne peut résister à la tentation et succombe rapidement aux courriels entre Emmi et Leo. Rapidement cette saine curiosité laisse place à un véritable voyeurisme, un besoin de savoir. On se retrouve exactement au même point qu’eux, essayant de décortiquer chaque mot, chaque phrase pour comprendre les sentiments qui se cache derrière chaque ligne. Bien plus qu’un roman d’amour, l’œuvre de Glattaeur se nourrit inlassablement de l’air du temps pour réinventer le genre. Et c’est pari réussi.